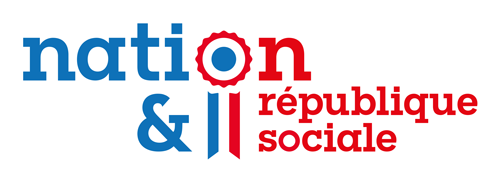Intervention de Gil Delannoi au lancement de Nation & République Sociale
Par Gil Delannoi, le 14 octobre 2018
Gil Delannoi est spécialiste du nationalisme, du libéralisme et de la pensée politique française contemporaine, professeur de théorie politique et d’histoire des idées à Sciences Po, directeur de recherche à la Fondation nationale des sciences politiques, membre du comité scientifique « sciences et citoyens » du CNRS, de la commission « philosophie » du Centre national du livre (2005-2007), de la commission des chercheurs de la FNSP et des comités de rédaction des revues Esprit, Commentaire, Zénon.

J’ai conçu ce texte à la fois comme une intervention aux problèmes politiques et intellectuels de notre époque, et en ce sens il est parfois ironique ; non pas polémique envers des personnes, mais peut-être envers des attitudes ou des idées. C’est le fruit de trente-cinq ans, jalonnés de plusieurs publications, de réflexion sur l’histoire des formes politiques que je réduis à quatre, comme l’avait fait Renan dans sa conférence : la tribu, la cité, la nation et l’empire, et ma propre approche de la double nature de la nation : politique et culturelle, ethnoculturelle. Cela nous donne la possibilité, non pas de savoir de quand date la nation culturelle – c’est très flou depuis que le mot existe en latin qu’on y a rangé tellement de choses que nous avons un objet extrêmement difficile à saisir mais, tout de même, utile pour parler de certaines réalités ou décrire certains faits historiques – mais à partir de la nation comme forme politique d’avoir un repère chronologique relativement précis et, je pense, peu contestable, ne serait-ce que parce qu’il a été créé simultanément dans deux univers culturels, certes occidentaux, mais différents qui sont les États-Unis et la France de la Révolution. À partir de là, je peux aussi m’interroger sur ce qu’est le nationalisme, en proposant ma propre approche, sinon théorique, qui emprunte évidemment à beaucoup d’auteurs qui sont cités – non pas Renan qui s’intéresse plus à la nation qu’au nationalisme, même si indirectement il s’oppose à une forme de nationalisme particulier qu’est celle du nationalisme allemand à l’époque, car la grande période d’essor du nationalisme allemand est le XIXe. Le début du XXe est plutôt sa dégénérescence en impérialisme raciste. Nous avons aussi des auteurs du monde académique, comme Gellner, Anderson, qui ont proposé leurs approches, que je critique dans mon livre [La nation contre le nationalisme], c’est la partie la plus académique, tout en en retenant certaines parties pour proposer ma propre lecture du nationalisme, après mon analyse historique de la nation. Cette lecture ayant pour volonté – et là nous sommes tout à fait à l’opposé de ce que j’appellerais la polémique contre le « natioscepticisme », la « natiophobie » ou l’obsession post-nationale d’aujourd’hui – de proposer une définition la moins polémique possible, c’est-à-dire qui convienne aussi bien à un nationaliste qu’à un antinationaliste et à quelqu’un qui croit en l’avenir des nations qu’à quelqu’un qui croit à leur déclin ou disparition. Et c’est en effet la volonté d’aboutir à une forme de conciliation, de coïncidence, de superposition de la nation politique et de la nation culturelle. Mon approche du nationalisme, générale, relève que ni la nation, ni même le nationalisme – contrairement à son emploi très particulier et provincial en France – ne sont en soi un bien ou mal. Ils sont des outils, des instruments, des formes – en anglais on dirait « polity ». C’est la colonne vertébrale de ce livre, avec une série de questions qui en découlent : quel est le monde dans lequel nous vivons ? Est-ce vraiment un marché global dans lequel les nations, les États et les États-nations vont disparaître ? Est-ce plutôt un système mercantiliste – c’est mon hypothèse – qui se maintient parce qu’il fait l’affaire de certains acteurs étatiques ou privés, ou relevant du monde de l’entreprise multinationale ? Un autre exemple peut-être de questionnement auquel on peut aboutir serait une interrogation sur la nature de l’Union européenne comme forme politique, sur son rapport avec l’existence des nations, sur sa finalité – est-ce de devenir une « super nation », une nouvelle forme d’empire, une fédération ? Mais l’Union européenne n’entre pas dans les critères de ce qu’est une fédération si nous prenons les exemples existants – pour faire court : les États-Unis ou la Suisse. Beaucoup de prérogatives d’une fédération ne constituent pas l’Union européenne, et elle en a certaines qui seraient exorbitantes dans ses propres pays. Donc vous voyez que nous sommes bien dans un cas historique différent ; c’est encore une question qu’on peut tirer du sujet tel que je l’aborde : comment sortir de l’énigme ou de la charade suivante : Delors avait dit « L’Union européenne est un objet politique non identifié », le problème étant que jusqu’à présent il a été un objet non identifié politique. Avec le paradoxe ironique, et imprévisible au moment où j’écrivais ce livre, qui est que les Britanniques qui voulaient eux-mêmes de cet objet définitivement non politique n’en sont pas moins sortis après avoir vu leur conception largement gagnante. Tout cela peut nous interroger ; il y a bien d’autres questions connexes sur l’avenir du nombre des formes politiques. Va-t-on vers un monde où la synthèse et l’association vont prévaloir, ou au contraire la dissociation en acteurs plus nombreux ? L’extension du modèle national ? c’est l’un des points des nombreux voyages ou séjour que j’ai pu faire sur différents continents m’en ont convaincu, même si c’est une vision plutôt avant-gardiste pour ceux qui la défendent, mais j’aurais tendance à dire « provinciale » de mon point de vue que de croire qu’on est jamais sorti de l’Union Européenne ou qu’on a visité un peu superficiellement le reste du monde, l’imaginaire ou le projet national auront disparu. C’est à peu près l’inverse. La pente est encore plutôt montante pour ce qui ressemble à la construction des nations et des États-nations hors de l’Europe. Il y a là aussi une sorte d’aveuglement et d’aveuglement sur soi-même à mon avis depuis 1989, puisque nous avons la démonstration qu’au cœur même de l’Union Européenne que l’unification, la vraie, celle qui eût lieu en Allemagne, le fut sous la thématique nationale. La nation n’a pas disparu, le monde sera certainement – ne serait-ce que pour des raisons techniques de communication instantanée – de plus en plus international, mais je pense qu’il ne sera pas post-national dans les décennies qui viennent. N’y voyez pas un penchant idéologique ou quoi que ce soit, c’est une simple constatation. Il est inutile de discourir sur des choses qui ne sont pas et ne seront pas, du moins à une échéance qui nous concerne. Je me garderai évidemment bien de faire des prédictions et de vous dire à quoi ressemblera la planète Terre si elle est encore habitable dans trois siècles. Mon idée n’est pas de vous répéter ce qu’il y a dans mon livre, mais d’évoquer un certain nombre de thèmes que j’aimerais que nous puissions discuter. Je reprends rapidement deux d’entre eux que j’ai rapidement évoqué :
Le premier, c’est « qu’est-ce qu’une nation aujourd’hui ? Pourquoi se fait-il que ce soit devenu, au fond, un objet de passions pro ou antination ? » Tout dépend évidemment dans quoi nous nous situons, dans quel pays, dans quel système politique, dans quelle aire culturelle… Il faut embrasser tous les détails pour se faire une idée. Chaque cas est différent. Loin de moi l’idée de connaître toutes les situations. Je crois qu’il faut avoir une approche réaliste et en terme d’idéologies. L’approche réaliste est très simple : on peut la dire en prolongeant les analyses d’Ernest Gellner – même si je suis pas d’accord avec lui sur tout – : si les élites des pays développés au début du XXe siècle étaient nationalistes, c’est tout simplement parce que les marchés étaient nationaux et au fond, l’adéquation entre leurs intérêts et leurs idées – et je le dis sans pratiquer la moindre forme d’adhésion à un marxisme ou un simplisme mais simplement parce qu’au-delà même du marxisme il y a des faits qui sont indiscutables – et peut-être par ricochet ou parallélisme politique, était nationaliste à leur époque. Mais il y avait différentes formes de nationalisme, ne l’oublions pas. Aujourd’hui, je dirais simplement que la situation est renversée. La Nation, aussi bien en termes culturels qu’en termes politiques, est devenue un obstacle pour le système mercantiliste mondial, qui s’est mis en place progressivement, mais qui est devenue une idéologique dominante depuis la chute de l’Union soviétique, avec en plus cette hybridation monstrueuse et fascinante qu’est la Chine avec son régime communiste et pratiquant une forme de nationalisme et de capitalisme un peu sauvage, ou un peu brutal.
Premier type d’explication : nous pouvons avoir recours simplement à ces données, non pas parce que les intérêts expliquent tout – et seulement dans certaines catégories de la population – mais parce que les intérêts comptent.
Il n’y pas que les intérêts ; c’est mon deuxième point : les passions. De ce point de vue, l’existence des nations est aussi confronté à un autre mouvement qui lui n’a rien d’économique, qui s’est greffé sur le premier et qui est un mouvement qu’on pourrait appeler une conception un peu différente de la démocratie. Non plus la démocratie sur base nationale, telle qu’elle existait depuis son apparition moderne, mais une démocratie qui devient, pour faire court, une idéologie multiculturelle, dont le centre même n’est plus l’intégration ou l’égalité de droits, voire des pratiques – qui est toujours plus difficile que l’égalité de droits –, mais beaucoup plus une forme de non-discriminations avec un mélange tout à fait intéressant : jusqu’à un certain point, il y a une fusion récente entre mes deux premiers points : même une mesure protectionniste timide et de bon sens va être présentée comme discriminatoire envers un marché étranger, ou d’une population. Ce qui m’intéresse, c’est comment ces choses se mélangent, s’hybrident, et là nous entrons peut-être dans des analyses qui sont moins simples à mener jusqu’au bout. Je ne le cache pas, ma position n’est pas favorable au multiculturalisme normatif – je ne parle pas du multiculturalisme de fait, que je peux apprécier comme tout le monde – parce que je considère qu’il est soit « autocontradictoire », soit qu’il est une manière indirecte de détruire ce qu’on a pu construire sans savoir ce qu’on va mettre à la place. En l’occurrence, il s’agit bien de la nation et de l’État-nation. Ce n’est pas un projet ouvertement destiné à détruire l’État-nation, mais c’est très certainement ce pour quoi il contribue, ou en tout cas à en fonder les bases ou la légitimité.
Dernier point – et là je m’adresse vraiment aux adversaires du nationalisme : je pense que, par ailleurs, cela va aboutir à l’effet inverse de l’effet recherché. C’est-à-dire que si l’on veut véritablement affaiblir l’imaginaire et la pratique de la nation, on risque au contraire d’avoir des nationalismes, nouveaux sans doute, peu conquérants, mais tendant à l’agressivité rentrée, et on obtiendra exactement le contraire de ce que l’on recherche ; d’où le titre du livre : la nation est aussi un remède contre un certain type de nationalisme.
Comme j’ai dit qu’il y avait plusieurs types de nationalismes, il est certain que celui d’un Gandhi à la fois décolonisateur, non violent, et Gandhi emploie les deux termes simultanément pour se décrire lui-même : « je suis cosmopolite et je suis nationaliste, car le cosmopolitisme n’est possible qu’entre des individus et entre des nations, puisqu’il faut une médiation entre l’individu et l’humanité et la meilleure des médiations possibles est une nation démocratique. » Si je voulais donner un tour positif à ma présentation, je dirais que c’est le modèle qui semble le plus vivable. Non pas qu’il soit sans défaut, mais c’est le modèle qui semble le meilleur.
« La vie démocratique n’est certainement pas les élections, les élections sont le résultat et non pas le point de départ d’une démocratie. »
Le second point que je voulais aborder avant de terminer ma présentation, c’est la relation, dans les polémiques, entre la nation et la guerre : « la nation c’est la guerre » et « le nationalisme, c’est la guerre à outrance ». Si l’on observe bien les choses, la vraie variable, ce n’est pas la nation, mais la démocratie, puisque les régimes démocratiques au sens fort du terme , quand ils n’ont plus d’empire colonial et quand ils ont une société pacifiée, avec un suffrage universel, avec une vraie vie démocratique – notion sur laquelle on pourra revenir, car la vie démocratique n’est certainement pas les élections, les élections sont le résultat et non pas le point de départ d’une démocratie – ces régimes-là ne se font pas la guerre, il n’existe aucun exemple, même et surtout quand ils sont des nations puisque les démocraties modernes sont toutes nationales. Cela pose tout de même un problème, ce cliché « le nationalisme c’est la guerre », comme l’a dit le Président de la République au Conseil de l’Europe. C’est quand même factuellement faux. Ce qui est vrai, et c’est peut-être une tragédie de l’histoire de la forme nationale, c’est que cette forme s’est beaucoup plus facilement répandue que la démocratie elle-même qui était née dans le même berceau. C’est-à-dire qu’on a pu, de façon relativement hypocrite, quand on était un dictateur, progressiste ou réactionnaire d’ailleurs, s’emparer de la forme nationale comme on s’est emparé de la conscription par exemple, qui aggrave considérablement l’aspect tragique des guerres en n’en faisant plus un choc entre armées professionnelles, mais une sorte de tragédie pour les populations civiles et les armées comme on le vit lors des deux guerres mondiales et ailleurs. On se trompe de variable sur ces questions sur lesquelles j’ai voulu attirer l’attention et clarifier autant que possible le débat, et quand je disais que ça a un aspect constructif, c’est parce que je propose vraiment au travers de cette réflexion des instruments ou des repères historiques, qui me semblent, après une longue réflexion et avoir affronté des objections et des critiques venues d’autres personnes que je m’adressais à moi-même qui semblent avoir résisté aux premiers tests. Et deuxièmement, je ne renonce pas à la polémique civilisée de remettre certains clichés en question, ou en tout cas montré en quoi ils sont particulièrement contradictoires ou de mauvaise foi. La plupart des démocraties ne sont pas des superpuissances. Donc, lorsqu’une superpuissance, même si elle est démocratique, se conduit comme une superpuissance, ce n’est pas parce qu’elle est démocratique ou nationale, c’est parce qu’elle est une superpuissance. Juger du modèle de l’État-nation uniquement sur le comportement des États-Unis me semble légèrement biaisé. D’autre part, j’ajoute que lorsque les démocraties – les démocraties nationales ou nations démocratiques – font des guerres, c’est soit parce qu’elles sont attaquées, soit parce qu’elles se conduisent en superpuissance, et encore n’ont-elles jamais attaqué des régimes que je qualifierai de démocratiques. Ainsi, si les États-Unis ont perdu la guerre du Viêt Nam, c’est parce que nous étions dans une situation de guerre froide, avec le soutien d’un empire qu’était l’empire soviétique, aux combattants vietnamiens, et c’est parce que les États-Unis étaient plus une démocratie qu’une superpuissance militaire qu’ils ne pouvaient gagner cette guerre contre la volonté de leur population, et c’était une guerre injustifiable du point de vue démocratique – ni leur patrie ni leur mode de vie n’étaient ni attaqués ni en danger – et c’était bien aussi une guerre patriotique de la part des Vietnamiens puisqu’ils ont ensuite fait la guerre contre le régime communiste chinois qu’ils ont gagnée. Vous voyez bien que ces exemples précis montrent que ce qu’on nous dit au sujet des relations entre guerre, nation et démocratie est un peu plus complexe que le cliché habituel.